Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs) Marshall Rosenberg

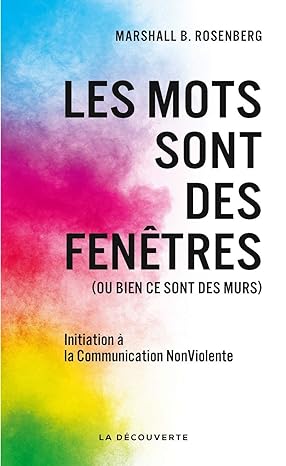
Résumé
La Communication non violente, nous propose l’empathie comme outil pour résoudre nos conflits intérieurs, réduire notre stress et apporter un soutien de qualité aux autres. Notre héritage culturel et éducatif nous a conditionnés à porter à nous-mêmes et aux autres des jugements de valeur (en terme de bien ou de mal) et un langage de déresponsabilisation « je dois » « il faut ». Or derrière ces reproches ou ces exigences, il existe des besoins insatisfaits source de souffrance ou des choix que nous avons faits.
Nous pouvons établir une communication bienveillante, si nous focalisons notre attention sur 4 étapes et aidons l’autre à en faire de même :
• observer une situation sans émettre de jugements de valeur
• identifier et nommer les sentiments que nous ressentons en présence de ces faits
• relier ces sentiments à des besoins insatisfaits
• adresser des demandes réalisables à une autre personne dans un langage d’action clair et concret
S’exprimer et entendre l’autre en privilégiant l’observation attentive de soi et de l’autre en terme de besoins et sentiments qui sous-tendent les messages échangés. Ce type de communication empathique peut s’appliquer à toutes situations d’interactions : couple, famille, école, travail, négociations diplomatiques…Ainsi nous éviterons la colère et donc les conflits qui viennent de nos jugements des torts de l’autre et de notre incapacité à bien identifier nos besoins insatisfaits.
Introduction
Marshall Rosenberg a créé cette méthode de Communication non violente que l’on peut appeler aussi Communication empathique. Celle-ci repose sur le postulat que nous possédons tous une bienveillance naturelle. En apprenant à diriger notre attention sur nos besoins et nos sentiments et en faisant preuve d’empathie pour soi et autrui, nous saurons clarifier les demandes de nos messages et déploierons ainsi notre bienveillance.
La violence émane d’un mode pensée qui attribue la cause du conflit aux torts de l’autre et à l’incapacité de reconnaître sa propre vulnérabilité ou celle de l’autre.
L’auteur présente, par cet outil, sa façon de résoudre les conflits interpersonnels dans le cadre de ses médiations, mais aussi son utilisation dans nos relations humaines quotidiennes.
Les 4 étapes de la méthode CNV
1. Observer sans évaluer
Il faut apprendre à distinguer l’observation de l’évaluation. Observer de façon factuelle le ou les comportements qui nous crée(nt) une gêne dans une situation donnée. Si nous évaluons, c’est à dire si nous portons un jugement moral, notre interlocuteur risque d’entendre une critique. Il faut éviter les généralisations figées et privilégier les observations circonstanciées; exemple page 58 de l’ouvrage : « En vingt matchs, je n’ai pas vu Jacques marquer un seul but » et non « Jacques est un mauvais joueur ».
2. Connaître nos sentiments
Pour apprendre à identifier et exprimer correctement nos sentiments, il faut distinguer les sentiments des interprétations mentales en étant attentif à la différence entre :
– ce que nous pensons être : « je me sens vraiment nul à la guitare », j’évalue ici ma compétence à la guitare, de ce que nous ressentons « Je suis impatient de progresser ».
– ce que nous interprétons des comportements d’autrui à notre égard : « je me sens insignifiant pour mes collègues », de ce que nous ressentons « Je suis découragé ».
Les actes d’autrui peuvent être le facteur déclenchant mais jamais la cause de nos sentiments dont nous sommes seul responsable. Nos sentiments proviennent de la façon dont nous choisissons de recevoir les actes et paroles d’autrui et en fonction de nos attentes et besoins à ce moment-là. Nous avons du mal à recevoir un message négatif car nous y réagissons en nous sentant fautif, ce qui fait baisser notre estime de soi, en rejetant la faute sur l’autre ce qui fait ressentir de la colère.
3. Repérer nos besoins
Les jugements sur les autres sont l’expression détournée de nos propres besoins ou valeurs insatisfaits. Si nous exprimons nos besoins, ils auront plus de chance d’être satisfaits que de parler des torts de l’autre qui entrainera auto-défense ou riposte.
Les besoins fondamentaux sont communs à tous les êtres humains :
Autonomie : liberté de choisir ses projets de vie et son plan d’action pour les réaliser.
Célébration : célébrer ses réalisations et ses pertes.
Intégrité : besoin d’authenticité, estime de soi…
Interdépendance : amour, appréciation, confiance, empathie, soutien…
Jeu : rire et amusement
Communion spirituelle : paix, ordre, inspiration…
Besoins physiologiques : eau, nourriture, protection…
Ce n’est pas aux autres de répondre à nos besoins. Nous devons assumer pleinement nos sentiments et sortir de « l’esclavage affectif », dans lequel nous nous croyons responsables des sentiments des autres.
4. Clarifier nos demandes
Utiliser un langage d’action positif, autrement dit dire ce que nous voulons plutôt que dire ce que nous ne voulons pas.
Formuler une demande en ayant pleinement conscience de celle-ci et formulée clairement, c’est à dire qu’elle soit accompagnée de nos sentiments et de nos besoins.
Demander un retour, pour s’assurer de la bonne réception de notre message, le remercier s’il le fait, faire preuve d’empathie s’il ne le fait pas, et rectifier si nécessaire la reformulation qu’il nous propose.
Demander de la sincérité sur ce qu’il pense au sujet de tel ou tel fait, de ce qu’il compte faire sur telle action à mettre en œuvre.
Adresser une demande à un groupe nécessite de préciser le type de retour qu’on en attend sinon on risque l’enlisement.
Notre demande ne doit pas être une exigence, sinon notre interlocuteur n’y répondra pas avec bienveillance (soumission ou révolte). Choisir de demander implique que nous ne tenterons pas de convaincre l’autre de répondre positivement à notre demande.
Définir l’objectif derrière notre demande
Pour que la CNV fonctionne, la relation se doit être sincère, c’est à dire, que nous ne cherchons pas à modifier le comportement de l’autre; et empathique, soucieux des besoins de l’autre, de ce qu’il vit.
Les entraves à la communication bienveillante
Nos jugements moralisateurs : nous avons tendance à croire et dire que l’autre a tort lorsqu’il ne partage pas nos valeurs. Nous allons alors le juger, l’évaluer en terme de bien (normal, bon, responsable…) et de mal (anormal, mauvais, irresponsable…)
Nos comparaisons : être comparé est bien souvent humiliant et nous éloigne de la bienveillance vis à vis de nous-mêmes et des autres.
Notre refus de responsabilité : dans le langage courant on utilise « il faut » ou « tu me », ces expressions forment un langage qui déresponsabilise de ses propres pensées et choix.
Quand nos désirs deviennent des exigences.
Quand nous pensons les actions en terme de mérite.
Le pouvoir de l'empathie
« Lorsque quelqu’un vous entend vraiment sans vous juger, sans essayer de vous prendre en charge ou de vous enfermer dans un moule, cela fait un bien incroyable… A partir du moment où j’ai été écouté et entendu, je parviens à percevoir mon univers sous un jour nouveau et à aller de l’avant. Il est étonnant de voir à quel point tout ce qui semblait insoluble trouve une issue dès lors que quelqu’un écoute. A quel point ce qui semblait irrémédiablement confus se dénoue de façon relativement claire lorsqu’on est entendu. » Carl Rogers cité par Rosenberg pge 157.
L’empathie est la capacité à recevoir avec respect ce que vit l’autre. Pour cela, il faut écarter tout jugement à son égard, faire le vide dans son esprit pour apporter toute notre attention à son message. Etre à l’écoute de ses sentiments et ses besoins pour mieux comprendre ses demandes. Il faut l’aider à explorer lui-même ce qu’il vit et formuler des demandes claires. L’écoute empathique apporte un soulagement et favorise la réciprocité.
Faire preuve d’empathie :
• ne pas donner de conseils trop hâtivement
• de pas vouloir résoudre les situations pour l’autre
• Reformuler les paroles de l’autre en utilisant une forme interrogative qui précise :
1. ce qu’il observe, (« Veux-tu parler du nombre de soirées où j’étais absent la semaine dernière? »)
2. ce qu’il ressent ou ce dont il a besoin : « Es-tu blessé parce que tu aurais aimé obtenir plus de reconnaissance pour tes efforts? »
3. Ce qu’il demande : « Veux-tu que je te dise pourquoi j’ai dit cela? »
• Si on souhaite demander des informations, il faut exprimer d’abord sentiments et besoin qui nous motivent.
Résolution des conflits et médiation par la CNV
En préalable, il faut créer un lien de sollicitude et de respect entre les personnes.
Puis nous suivons 5 étapes de la résolution de conflit :
1. Exprimer nos besoins
2. Trouver les besoins réels de l’autre.
3. Vérifier que chacun a bien identifié ces besoins.
4. Donner autant d’empathie que nécessaire pour que les 2 parties entendent les besoins de l’autre.
5. Proposer des stratégies de résolution du conflit exprimées dans un langage d’action positif.
On confond souvent les besoins et les stratégies mises en place pour satisfaire ceux-ci. Ce sont ces stratégies qui amènent le conflit. La souffrance accumulée rend parfois difficile cette écoute. Il faut alors faire preuve de beaucoup d’empathie vis à vis de cette personne pour ensuite revenir sur cette étape essentielle d’entendre les besoins de l’autre. Une fois que chaque partie s’est reliée aux besoins de l’autre, on peut passer à l’étape des stratégies qui satisfont ces besoins.
Il faut utiliser un langage du présent (ce qu’on veut ici et maintenant), formuler des demandes en terme d’action positive (ce qu’on veut) et pas de terminologie vague (de la liberté, de l’écoute etc..).
En conclusion
Pour Rosenberg, notre volonté de changer le comportement désiré de l’autre nous amène à masquer des exigences derrière nos demandes et à nous comporter de façon répressive, négative. Ce faisant, nous n’obtenons que le renforcement du comportement non désiré car ces attitudes entament la sincérité des rapports et l’estime de soi. La CNV nous apprend à être dans des rapports humains sincères. Elle nous apprend à exprimer notre reconnaissance et à recevoir un compliment, à ne plus avoir peur de l’autre et à être bienveillant avec nous-mêmes. La non expression de nos sentiments vient de l’idée que cela nous rend vulnérable aux autres.
Elle nous aide à comprendre que les paroles et les actes d’autrui peuvent être un facteur déclenchant, mais jamais la cause de nos sentiments qui nous sont propres, Epictète au 1er siècle : » Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes mais l’opinion qu’ils en ont. »
La CNV est une des méthodes pour apprendre à clarifier nos représentations et celles des autres et parvenir à une meilleure compréhension réciproque.
L’empathie, bien plus qu’une attitude est un état d’esprit qui nous invite à vider notre esprit de nos représentations inévitables, à faire preuve de curiosité respectueuse.
Il faut aussi être convaincu de la capacité des personnes à trouver leur propre solution sous peu qu’on les aide à découvrir ce qui crée leur souffrance, autrement dit leurs besoins insatisfaits.